Colloque international "Les Formes de la mémoire"
Du 5 nov. au 7 nov. 2025
Du 5 au 7 novembre 2025, le laboratoire ALTER de l'UPPA organise un colloque international sur le thème "Les formes de la mémoire" sur le campus de Pau (amphithéâtre de la Présidence).
Il sera consacré à la langue de la mémoire dans la littérature, de l’Antiquité à nos jours. Explorez les manifestations formelles de la mémoire, la construction d’une mémorisation par les ressources langagières ou encore la mise en forme du souvenir grâce aux intervenions et discussions avec les 25 chercheurs.
À cette occasion, une exposition de planches de bandes dessinées sera installée du 5 au 19 novembre dans le hall des sciences du campus de Pau. Ces reproductions de planches sont tirées de plusieurs œuvres (Là où tu vas : voyage au pays de la mémoire qui flanche, La Parenthèse, Le Petit Frère et Un père) dont le commentaire est le fruit du travail mené en cours sur la période septembre-octobre par une quarantaine d’étudiants de licence et de master. Des planches extraites de la revue Ébullitions seront également affichées.
Télécharger le programme (PDF, 1,21 Mo)
Deux temps forts :
- Mercredi 5 novembre 2025 à 18h15
Vernissage de l’exposition en présence des auteurs. - Jeudi 6 novembre de 16h00 à 17h30
Table ronde "Les formes de la mémoire en bande dessinée", rencontre avec Étienne Davodeau (Là où tu vas. Voyage au pays de la mémoire qui flanche, Futuropolis, octobre 2025), Élodie Durand (La Parenthèse, Delcourt, 2018) et Jean-Louis Tripp (Le Petit Frère et Un Père, Casterman, 2022 et 2025).
Télécharger l'appel à communication
Dans la continuité des artes memoriae, le titre de l’ouvrage fondateur de Frances A. Yates désigne la mnémotechnie comme l’art de la mémoire. Or le mot français « art » qui, lorsqu’il désigne l’ensemble des moyens par lesquels l'homme tend à une certaine fin, a pour synonyme « technique », réfère aussi à l’expression d’un idéal esthétique, et sa polysémie rend compte de la jonction entre la création littéraire et les procédés expressifs qui assurent sa transmission. Ce sont précisément ces procédés, cette langue de la mémoire que se propose d’observer ce colloque.
Le pouvoir d’une œuvre, d’un discours ou d’une formule à demeurer dans notre mémoire à travers les époques, qu’elle soit individuelle, lorsqu’elle est propre à un être, collective, quand elle est partagée par un groupe qui se définit entre autres par ce souvenir partagé, ou historique, dès lors que ce passé commun est objectivé en connaissance, conserve une grande part de mystère. Comment le désir de faire mémoire s'inscrit-il formellement dans la langue d’une œuvre ?
Ce projet se veut diachronique, et conduira ses questionnements notamment dans les langues et cultures de l’Antiquité, dans la langue et la culture médiévales, dans celles de la France de l’ancien régime, dans ses périodes modernes, jusqu’à l’état contemporain de notre langue et de notre société. Si la visée première est d’examiner la construction d’une mémorisation par les ressources langagières, syntaxiques, rhétoriques et stylistiques, dans la lignée de ce que la rhétorique antique désigne sous la notion de memoria, ce sont plus généralement les formes de production du sens qui seront interrogées, par exemple à propos d’une case de bande dessinée qui se voit constituée en patrimoine. Aussi, le champ considéré sera prioritairement littéraire, sans exclure, bien au contraire, des liens avec ce que des chercheurs en histoire, ou en neurologie, ou encore en didactique, peuvent montrer du fonctionnement et de la construction de la mémorisation ainsi que du souvenir.
Les formes de la mémoire se comprennent comme sa langue, comme son expression, comme les ressources langagières qui permettent la mémorisation d’un énoncé, qui l’ancrent dans la mémoire. Faire mémoire par la langue, c'est mobiliser la mémoire du lecteur, rendre une œuvre mémorable. La mémoire aurait ainsi ses patrons formels, sa syntaxe, son lexique, ses figures, sa versification, son énonciation, sa typographie, sa matérialité sur la page. Il serait à cet égard possible de constituer une grammaire de la mémoire, qui s’intéresserait à l’« ensemble de règles conventionnelles (variables suivant les époques) qui déterminent un emploi correct (ou bon usage) » des procédés mnémotechniques (TLFi), mais qui se voudrait aussi, et plus largement, une « étude objective et systématique des éléments (phonèmes, morphèmes, mots) et des procédés (de formation, de construction, d'expression) qui constituent et caractérisent le système d'une langue naturelle » (TLFi), ici celle de la mémoire. Les ressources mnémotechniques pourraient aussi se distinguer selon que les dispositifs sont explicites ou implicites. De même, il serait intéressant de voir si elles diffèrent selon que la mémoire opère de façon volontaire ou involontaire, en d’autres termes selon que les souvenirs du lecteur répondent aux intentions de l’auteur, ou bien les déçoivent, ou bien encore les débordent.
L’enjeu sera alors de rendre compte de la charge mémorielle de la langue, des faits de langue à l'origine d’une mémoire non seulement volontaire, mais encore involontaire, spontanée, qui s’impose au lecteur et à l’auteur. Il s’agira également de voir comment les émotions, c’est-à-dire, ici, comment les ressources langagières à l’origine des émotions – moyens syntaxiques, lexèmes, images, dispositifs de versification, de mise en page, configurations énonciatives, stylèmes – sollicitent et nourrissent la mémoire vive du lecteur. Les formes de la mémoire peuvent aussi, conjointement, être les ressources langagières qui représentent la mémoire, celles par lesquelles elle s'exprime, ce qui constituerait la langue parlée par la mémoire. Il s’agit dans cette autre perspective de décrire les manifestations formelles de la mémoire, la mise en œuvre du souvenir dans les formes expressives, d’observer les contours pris dans le discours par le souvenir, la réminiscence. Pour résumer : comment la langue exprime-t-elle la mémoire, au sens premier, concret, où elle permet d’extraire – d’ex-primer – du texte la mémorisation, la mémoire qu’il contient, et au sens second, figuré, où elle rend sensible la mémoire par la représentation qu’elle donne d’un souvenir ou d’un oubli ?
Ces problématiques peuvent être explorées à partir de ces quelques entrées, qui se veulent suggestives et non limitatives :
- la nature des procédés mnémotechniques : quels aspects de la langue se trouvent plus particulièrement sollicités, ou s’avèrent efficaces, pour faire mémoire ? ou pour représenter la mémoire, le souvenir ? comment sont-ils mis en œuvre ? comment opèrent-ils ?
- les répertoires des ressources mnémoniques : comment ces procédés étaient-ils présentés et organisés ? qui constituait ces nomenclatures, les diffusait, et à quelle fin ? quels genres se trouvaient observés ? ou, symétriquement, constitués de ce recueil de procédés ?
- les usages didactiques des propriétés mnémoniques : comment écrivait-on pour se souvenir dans l’antiquité gréco-romaine ? et pendant le Moyen-Âge ? et dans la période moderne ? et aujourd’hui ?
- les spécificités des formes mnémoniques selon les époques : que nous disent les traités de la mémoire des différentes périodes littéraires ? comment l’image de la maison de Mémoire traversa-t-elle les époques ?
- les spécificités des formes mnémoniques selon les genres littéraires : par exemple, pour le théâtre, comment le texte dramatique porte-t-il la mémorisation de l’acteur ? Ou dans une bande dessinée, comment matérialiser à l’échelle de la case, de la planche ou de l’album l’effort pour se souvenir ou l’impossibilité d’oublier, notamment dans le cas d’une mémoire traumatique ? comment transcrire les perturbations provisoires ou permanentes de la mémoire et leur « envahissement » dans l’esprit d’un personnage réveillé ou endormi ? quels liens textuels et iconiques sont éventuellement établis entre mémoire, rêves, cauchemars et hallucinations ? Ou pour un texte poétique notamment, comment l’espace de la page participe-t-il de la construction de la mémorisation, ou bien de l’expression du souvenir ?
- les limites de ces ressources mnémoniques : qu’est-ce qui, dans la forme littéraire, peut entraver la mémorisation ? comment les formes qui expriment l’oubli s’articulent-elles à celles de la mémoire ? à l’inverse, comment le caractère mémorable d’un énoncé peut-il déborder l’intention de son auteur ? comment l’écriture peut-elle bâtir l’illusion d’un souvenir ?
Bibliographie indicative
Badiou-Monferran Claire (dir.), « La rémanence : un concept opératoire pour la linguistique diachronique ? Le cas du français », Le Français moderne, 2020/2, 2020.
Baroin Catherine, Se souvenir à Rome. Formes, représentations et pratiques de la mémoire, Belin, Paris, 2010.
Belin Olivier, Bello Anne-Claire, Radut-Gaghi Luciana (dir.), « La Littérature en formules », Fabula-LhT, n° 30, décembre 2023 [en ligne].
Carruthers Mary, Le Livre de la mémoire. Une étude de la mémoire dans la culture médiévale, trad. Diane Meur, Paris, Éditions Macula [édition originale : The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge University Press, 1990], 2002.
Demarolle Pierre, Roig Miranda Marie (dir.), Les Genres littéraires de la mémoire, Nancy, Presses universitaires de Nancy, coll. « Europe XVI-XVII », 2008.
Fasseur Valérie, « La mémoire volontaire de l'écrivain médiéval : aspects et enjeux de la remembrance », Littérature, 2014, 3, p. 6-22.
Fesenmeier Ludwig, Novakova Iva (dir.), Phraséologie et stylistique de la langue littéraire. Phraseology and Stylistics of Literary Language. Approches interdisciplinaires. Interdisciplinary Approaches, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, Peter Lang, 2020.
Halbwachs Maurice, La Mémoire collective, éd. critique établie par Gérard Namer, Paris, Albin Michel, « Bibliothèque de l’Évolution de l’Humanité », [1re éd. Presses Universitaires de France, 1950] 1997.
Maldidier Denise, L’Inquiétude du discours, textes de Michel Pêcheux choisis et présentés, Paris, Éditions des Cendres, 1990.
Moirand Sophie, « Les lieux d’inscription d’une mémoire interdiscursive », dans Härmä J. (dir.), Le Langage des médias : des discours éphémères ?, Paris, l’Harmattan, 2003, p. 83-111.
Nora Pierre, Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, « Quarto », [1re éd. 1984-1992] 1997.
Karol Mariana, « La transmission : entre l’oubli et le souvenir, le passé et l’avenir », Le Télémaque, 2004/2 (n° 26), p. 103-110 [en ligne].
Krieg-Planque Alice, « La petite phrase : un objet pour l’analyse des discours politique et médiatique », Communication et langage, n° 168, 2011, p. 23-41 [en ligne].
Paveau Marie-Anne, Les Prédiscours, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006. Également disponible en ligne sur OpenEdition Books depuis le 12 avril 2017. [en ligne].
Pêcheux Michel (dir.), « Analyse du discours, langue et idéologies », Langages, 37, 1975.
Ricœur Paul, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, « Points », 2000.
Thomas Jean-François, « Les verbes de la mémoire en latin », dans R. Ph., 2021 (paru en 2023), 95-2, p. 185-210.
Yates Frances A., L'Art de la mémoire (1966), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », [1re éd. 1966] 1975.
Modalités de soumission
Les propositions de communication, entre une demi-page et une page (hors images éventuelles et références bibliographiques) sont à envoyer avant le 20 mars 2025 aux trois organisatrices au format .docx exclusivement, en nommant les fichiers sur le principe suivant : NOM-Uppa-memoire (sans accent ni espace ni autre signe diacritique), ex. DUPONT-Uppa-memoire.docx
La proposition de communication sera suivie d’une présentation biobibliographique de 4-5 lignes.
Les communications pourront être filmées dans le cadre d’un enregistrement ou d’une retransmission en visio.
Les repas de midi à l’Université seront pris en charge (pour les repas du soir, les déplacements et les hébergements : sous réserve).
Comité d’organisation
Julie Gallego (Arts/Langages : Transitions & Relations, ALTER ; Université de Pau et des Pays de l’Adour, UPPA) julie.gallego @ univ-pau.fr
Bérengère Moricheau-Airaud (Arts/Langages : Transitions & Relations, ALTER ; Université de Pau et des Pays de l’Adour, UPPA) berengere.moricheau-airaud @ univ-pau.fr
Cécile Rochelois (Arts/Langage : Transitions & Relations, ALTER ; Université de Pau et des Pays de l’Adour, UPPA) cecile.rochelois @ univ-pau.fr
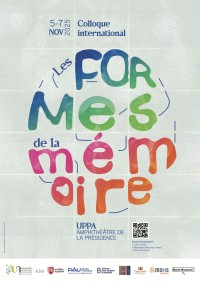
_Page_2_313x224.jpg)