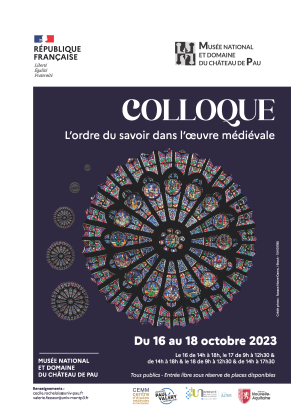Colloque " L'ordre du savoir dans l'oeuvre médiévale"Pau - Musée du château
Du 16 oct. au 18 oct. 2023
Colloque organisé par le laboratoire ALTER (Université de Pau et des Pays de l’Adour) et le CEMM (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
L’inclusion d’un savoir dans une œuvre littéraire médiévale peut obéir à plusieurs intentions avouées : en faire mémoire, le transmettre, l’exploiter en tant qu’instrument agent doté d’une efficacité sur le lecteur. Toujours pensée dans l’intention d’un partage, la forme donnée au savoir dans la littérature, qu’il s’agisse d’un savoir sur le monde, d’un savoir doctrinal, d’un savoir littéraire ou intertextuel, dépend tout à la fois de sa nature, de sa fonction, de son auteur et de son public. Il est ainsi à la croisée de critères de création et de réception qui rejaillissent nécessairement sur sa disposition textuelle, à une époque où le souci de la dispositio l’emporte sur celui de l’inventio[1]. L’ordre du savoir est tout autant son agencement que l’exigence qu’il imprime à la forme du texte qu’il habite. Dans la littérature médiévale, cet ordre devient de plus en plus visible au fil des siècles, avec le développement des traités dont l’organisation est explicitement indiquée par les tables des matières, les index ou encore par le jeu des renvois. D’autres marqueurs ont aussi pour mission de signaler l’ordre du savoir : chapitrage, intertitres, rubriques, pieds de mouche, lettrines, autant de moyens visibles d’articuler et de donner à voir l’organisation. Mais l’ordre du savoir, d’autant plus discret que les auctoritates chez qui il est puisé sont rarement nommées[2], tout en déterminant les formes et les modalités de sa transmission littéraire, peut aussi rester invisible à l’œil nu. Dissimulé par la fiction[3], combiné à d’autres agencements textuels[4], il peut nécessiter un travail d’exploration, voire de décryptage. La réflexion pourra s’orienter de diverse manière non exclusive :
- observation et mise en évidence de la logique des marqueurs visibles ; respect ou écarts dans le texte par rapport à la programmation explicite ; logique ou arbitraire des listes, des énumérations.
- mise au jour de l’organisation du savoir dissimulé ; combinaison de différents principes de classement
- entorses à l'ordre préalable (sources, versions plus anciennes dans la tradition manuscrite, adaptation de l'ordre des savoirs liée à la traduction) ; ellipses et insertion de nouvelles entrées
- analyse de l’efficacité herméneutique ou agente de la dispositio du savoir (intention maïeutique, prosélytiste, etc.)
- on accordera une place particulière à tout ordre paradoxal, notamment aux figures de retournement qui traversent la production littéraire médiévale, de la rhétorique de l’ordo artificialis et de la métaphore de l’inversion sexuelle dans le De Planctu Naturae d’Alain de Lille jusqu’au rondeau Ma fin est mon commencement de Guillaume de Machaut, en passant par la puissance matricielle de retournement qu’est l’Eucharistie selon Pierre le Vénérable[5] et telle qu’elle éclaire les retournements insolites du Haut Livre du Graal[6], ou encore, sous l’influence de la théologie négative.
Contacts :
Cécile Rochelois : cecile.rochelois @ orange.fr
Valérie Fasseur valeriefasseur @ orange.fr
[1] Jean-Yves Tilliette, Des mots à la parole, Genève, Droz 2000, p. 73-85.
[2] Alain de Libera, « De la lecture à la paraphrase. Remarques sur la citation au Moyen Age » Langages 73 (1984), p. 17-29.
[3] Savoirs et fictions au Moyen Age et à la Renaissance, Dominique Boutet et Joëlle Ducos éd., Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 2015
[4] Par exemple, à propos du Roman de la Rose de Jean de Meun, voir Jean-Marc Mandosio, « La classification des sciences dans le Miroir des amoureux et l’érotologie de Jean de Meun », Jean de Meun et la culture médiévale. Littérature, art, sciences et droit aux derniers siècles du Moyen Âge, sous la direction de Jean-Patrice Boudet, Philippe Haugeard, Silvère Menegaldo et François Ploton-Nicollet, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 137-173.
[5] Dominique Iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam 1000-1150, Paris, Aubier, 1998, p. 173-174.
[6] Valérie Fasseur, Paradoxes du lettré, Genève, Droz, 2021, p. 649-660.
Programme
Lundi 16 octobre 2023
Après-midi
14h - Accueil des participants et ouverture du colloque, par Paul Mironneau, Conservateur du Musée national du Château de Pau, Monique Luby-Gaucher, VP CA de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et Hélène Laplace-Claverie, directrice d’ALTER.
14h30 - Introduction par Valérie Fasseur, Université Paul-Valéry Montpellier 3, et Cécile Rochelois, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Ordonner et lire le monde - Présidence : Jean-Marie Fritz, Université de Bourgogne
15h00 - Yoan Boudes, Université de Rouen, « Bêtes en série : savoir à répétition et structure formelle dans les bestiaires français »
15h30 - Christine Silvi, Sorbonne Université, « L’Image du monde qui ‘a Dieu commence, a Dieu prent fin’ : mise en scène de l’ordre du monde et de l’ordre du savoir dans un livre de clergie du XIIIe siècle »
16h00 - Louis-Patrick Bergot, Université de Strasbourg, « La disposition des pierres précieuses dans les lapidaires apocalyptiques : mise en ordre exégétique d'un savoir gemmologique »
16h30 - Discussion
Mardi 17 octobre -
Matinée
Réordonner : éprouver et interpréter - Présidence : Jean-Yves Tilliette, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Université de Genève
9h00 - Mathias Sieffert, Université Paul-Valéry Montpellier 3, « L'ordre du savoir amoureux dans le Dit de l'Alérion de Guillaume de Machaut »
9h30 - Samanta Molinaro, Université de Poitiers, « Réminiscences ovidiennes dans l’œuvre poétique de Raimbaut d’Aurenga : le cas de Assatz sai d’amor ben parlar (BdT 389.18) »
10h00 - Guillaume Oriol, Université de Bordeaux Montaigne – EPHE, « Les paradoxes d’une grammaire des émotions. Tentatives d’une saisie des émotions par l’ordre rhétorique dans les lyriques médiévales d’oc et d’oïl (XIIe-XIIIe siècles). »
10h30 - Discussion et pause
11h00 - Elsa Marguin-Hamon, Ecole nationale des chartes, « Plans concurrents, ambiguïtés génériques, polyphonie herméneutique : le De Triumphis Ecclesie de Jean de Garlande (av. 1258), un palimpseste ? »
11h30 - Paul Mironneau, Directeur du Musée national du Château de Pau, « De la liberté dans la glose : l’esprit critique de Pierre Bohier (vers 1310-1387) »
12h00 - Discussion
Après-midi
Ordre ou désordre : le chemin du savoir - Présidence : Jean Meyers, Université Paul-Valéry Montpellier 3
14h Andrea Giraudo, Université de Turin, « Le Romanz des trois anemis à travers ses sources : type, rôle, ordre interne et inventaire externe »
14h30 Richard Trachsler, Université de Zürich, « De la règle à l’ordre. Remarques sur l’Espirituel jeu de la paulme »
15h00 - Amandine Mussou, Université Paris-Cité, « Monter les marches, compter les vertus : logique énumérative et schéma numéral dans les dits de Watriquet de Couvin »
15h30 - Discussion et pause
Présidence : Richard Trachsler, Université de Zürich
16h00 Sandrine Hériché Pradeau, Sorbonne Université, « Les Arbres des Béatitudes dans Le Chemin de Vaillance de Jean de Courcy »
16 h 30 - Florian Dimeck, Docteur de l’Université d’Aix-Marseille, « Impossible est rédiger par histoire. La raison du désordre des œuvres moralisatrices de Pierre Gringore »
17h00 - Isabelle Fabre, Université Paris-Ouest Nanterre, « Entre ordre et désordre : la connaissance de l’âme dans le Miroir des simples âmes de Marguerite Porete »
17h30 - Discussion
20h - Concert : Ensemble Doulce Mémoire
Présentation par Denis Raisin-Dadre, directeur de l’ensemble Doulce Mémoire et Mathias Sieffert, Université Paul-Valéry Montpellier 3
Mercredi 18 octobre
Matinée
Ordonner pour persuader - Présidence : Isabelle Fabre, Université Paris-Ouest Nanterre
9h00 - Baptiste Laïd, Université de Pau et des Pays de l’Adour, « Comment chapitrer ? L’exemple de la Disciplina clericalis et de ses mises en français »
9h30 - Daniele Sorba, Université de Sienne – EPHE, « Les rédactions parallèles des Sermons Limousins : constantes et divergences significatives »
10h00 - Discussion et pause
10h30 - Marie-Madeleine Huchet, Université Paris-Est Créteil, « Mettre en ordre le savoir dans la fiction : les sermons en français attribués à Maurice de Sully dans le manuscrit Bodmer 147 »
11h00 - Catherine Nicolas, Université Paul-Valéry Montpellier 3, « Et libero arbitrio : formes du discours théologique et disposition romanesque dans la Mort Artu »
11h30 - Discussion
Après-Midi
Insertions, interpolations : créer un ordre nouveau - Présidence : Paul Mironneau, Musée national du Château de Pau
14h00 - Jean-Yves Tilliette, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres – Université de Genève, « La Vie de saint Malch de Reginald de Canterbury (ca. 1100) : une encyclopédie ludique ? »
14h30 - Jean Meyers, Université Paul-Valéry Montpellier 3, « Du savoir mythologique dans le récit de voyage de frère Félix Fabri (fin XVe s.) »
15h00 - Discussion et pause
15h30 - Guillaume Andreucci, Université Paul-Valéry Montpellier 3, « Ordres du manuscrit, désordres de la nature. Remarques sur les insertions propres au manuscrit M du Roman de Renart »
16h00 - Jean-Marie Fritz, Université de Bourgogne, « Excroissances et défigurations : l'insertion de l'histoire d'Alexandre et de la chronique universelle dans les deux versions de Renart le Contrefait »
16h30 - Discussion
17h00 Conclusions : Elisabeth Pinto-Mathieu, Université d’Angers